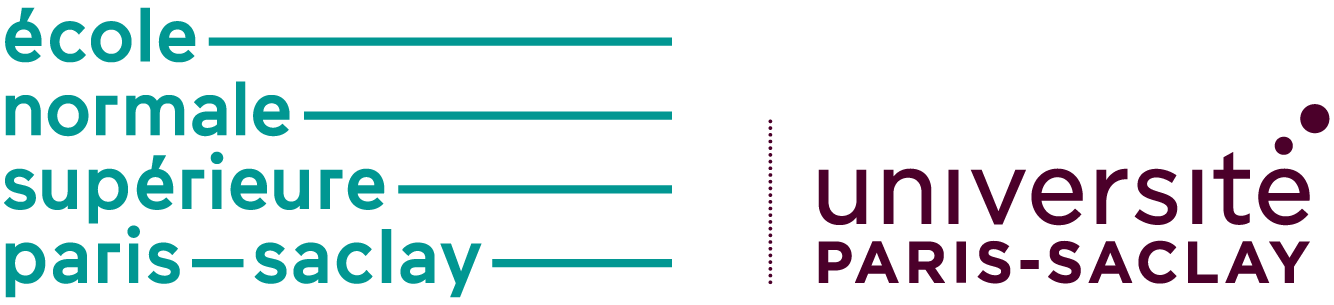Nouvelle percée en imagerie spectrale : l’analyse en 3D de matériaux photosensibles via un "jumeau numérique"
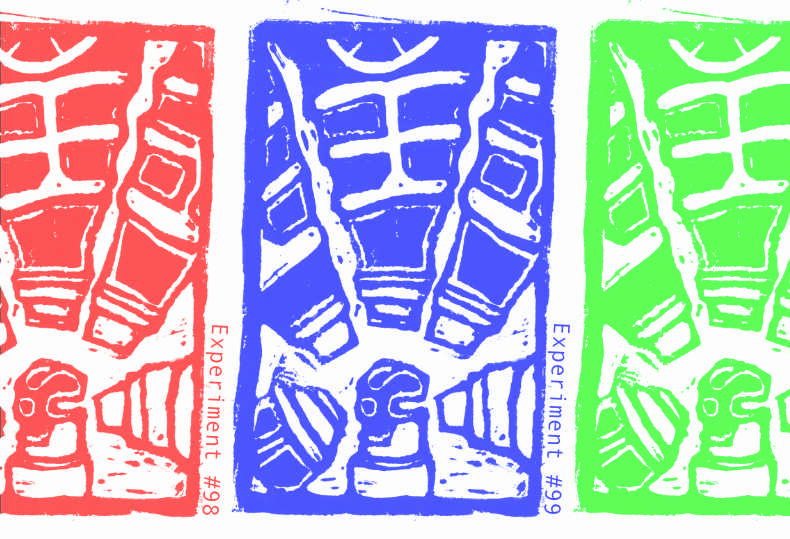
Ils ont étudié les conditions pour minimiser la dose de rayons X appliquée à un échantillon lors de son analyse. En créant un jumeau numérique de l’expérience, ils ont pu explorer un vaste ensemble de paramètres expérimentaux. Leur étude, parue dans la revue Science Advances, montre qu’il est possible de diviser par dix la dose utilisée tout en conservant la capacité à déterminer la stratigraphie d’un échantillon de peinture, en s’appuyant sur les valeurs optimales identifiées par l’algorithme.
Cette approche permet désormais l’analyse d’échantillons très photosensibles en recourant à des méthodes auparavant jugées trop agressives pour ces matériaux.
L’imagerie spectrale
En analyse photonique, on obtient un spectre en envoyant un faisceau sur un échantillon, en faisant varier un paramètre, souvent l’énergie incidente (ou réémise) et en collectant la réponse sur un détecteur. En recueillant le signal pixel par pixel, on génère une image spectrale. Celle-ci est qualifiée d’hyperspectrale lorsque la gamme d’énergie est continue, et de multispectrale lorsqu’elle est discrète.
L’imagerie spectrale par excitation photonique dans la gamme des rayons X, UV ou visible est largement utilisée pour identifier les composés chimiques et classifier les pixels selon leur composition mais aussi pour classer spatialement les systèmes matériels pour différents domaines d'application : la télédétection par satellite, la gestion forestière, la biologie végétale, l'alimentation et la chimie du patrimoine.
Cependant, de nombreuses modalités d’imagerie impliquent des doses élevées d’irradiation, susceptibles de conduire à un endommagement irréversible des échantillons.
Préserver l’intégrité de l’échantillon et analyser des matériaux photosensibles
Les techniques d'imagerie spectrale de pointe sont confrontées à un compromis inhérent entre l'intensité du signal et l'intégrité de l'échantillon.
En imagerie chimique, la grande quantité d'informations collectées avec l’imagerie hyperspectrale et multispectrale implique une dose de rayonnement électromagnétique élevée, nécessaire pour recueillir un signal suffisant mais peut endommager de manière irréversible les échantillons inorganiques et, plus encore, les échantillons organiques. Différentes approches sont utilisées pour obtenir des statistiques de comptage suffisantes tout en atténuant les dommages, comme la congélation cryogénique. Cependant, les températures froides peuvent elles-mêmes être très préjudiciables à l'intégrité des échantillons.
Par ailleurs, les stratégies basées sur l'augmentation de la taille du faisceau, la réduction du flux du faisceau et/ou du temps de pause ont un impact important sur les données collectées. La réduction de la dose peut poser le défi de démêler le signal collecté. Un choix critique doit donc être fait pour trouver un compromis entre la préservation des échantillons et la quantité de connaissances collectées.
Traditionnellement, l'optimisation des paramètres d'acquisition, tels que la longueur d'onde de la source, l'intensité et le temps d'exposition, repose sur des ajustements empiriques visant à améliorer le contraste de l'image.
L’imagerie spectrale Raman à rayons X
Les chercheuses et chercheurs ont considéré une méthode particulièrement prometteuse : la diffusion Raman de rayons X. Cette technique sur grand instrument (synchrotron) a la capacité unique de sonder les éléments légers en 3D (carbone, oxygène, azote, etc.). Néanmoins, elle nécessite des doses d’irradiation extrêmement élevées, rendant l’analyse de matériaux photosensibles impossible.
la création d’un « jumeau numérique » ouvre la voie à l’analyse en 3D de matériaux photosensibles
Afin de contourner cet obstacle, ils ont élaboré le "jumeau numérique" d’une expérience d’imagerie — c’est à dire une modélisation virtuelle de l’expérience, couplant données expérimentales et "synthétiques", permettant de simuler le résultat obtenu en faisant varier numériquement les paramètres de l’expérience.
Ils ont démontré que le développement d'un "jumeau numérique" adapté permet la mise en œuvre de l'imagerie d'échantillons organiques radiosensibles. Ils ont en effet testé un très grand nombre de configurations expérimentales et identifier celles menant à une meilleure classification des espèces chimiques.
Son utilisation a permis de diviser par dix le temps d'acquisition tout en maintenant le fonctionnement en dessous du seuil de dommage, ouvrant la voie à une imagerie spectrale haute-définition avec une dégradation minimale des échantillons organiques sensibles.
En fixant la dose subie par l’échantillon, ils ont déterminé les conditions expérimentales qui permettraient de collecter des données sur une coupe de peinture, particulièrement photosensible.
L’hybridation du monde réel de l’expérience et de celui, synthétique, du jumeau numérique a permis d'obtenir une spéciation 3D des matériaux photosensibles et ouvre la voie à des modalités d'imagerie plus rapides et plus efficaces, préservant les échantillons de la biologie à la chimie et aux sciences des matériaux.
Un travail interdisciplinaire et muti-établissement
L'équipe internationale est composée de :
- Laure CAZALS, Lauren DALECKY et Loïc BERTRAND du laboratoire de chimie, "Photophysique et Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires" (PPSM - ENS Paris-Saclay, CNRS, Université Paris-Saclay),
- Agnès DESOLNEUX du laboratoire de mathématiques, le Centre Borelli (ENS Paris-Saclay, CNRS, Université Paris-Saclay)
- Simo HUOTARI du département de Physique de l'University d'Helsinki,
- Christoph SAHLE et Alessandro MIRONE du synchrotron européen ESRF, et
- Serge Cohen du laboratoire IPANEMA (CNRS, UVSQ, MNHN, ministère de la Culture)
Ces travaux ont été initiés par une collaboration inédite entre les départements de chimie et de mathématiques de l’ENS Paris-Saclay, et a bénéficié d’un Long Term Project au synchrotron européen ESRF (HG-171). Ils ont été financés par la Commission européenne dans le cadre du projet GoGreen (GA no. 101060768).