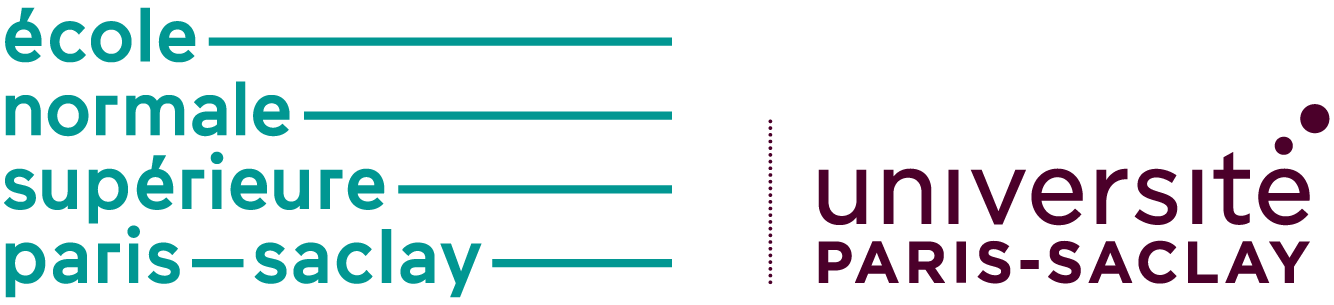Le pro bono des cabinets d'avocats et des multinationales du droit
Pratique importée des États- Unis, le pro bono est devenu, depuis une quinzaine d’années en France, un phénomène en vogue.
Expression d’un ethos de service public aussi bien que d’un désir de soigner la réputation professionnelle des avocat-e-s, il va bien souvent de pair avec le développement, dans les cabinets, du droit des affaires, pratique rémunératrice à même de financer les programmes pro bono de ces derniers.
Il implique également un mode particulier de facturation de l’activité (pour faire simple : à l’heure plutôt qu’au forfait). Ces caractéristiques sont susceptibles d’entrer en conflit avec la structure organisationnelle du barreau français, au sein de laquelle l’avocat dit « indépendant » joue encore un rôle non négligeable. Une partie significative de la profession continue en effet à pratiquer dans de petites structures ( < 10 avocat-e-s ), et n’a pas grand-chose de comparable avec les lawyers exerçant dans les multinationales du droit (Bessy, 2015, p. 129-179).
Le pro bono et New Public Management
Le présent papier entend resituer le phénomène du pro bono dans une perspective de sociologie de l’action publique, en le traitant comme une forme d’externalisation du service public de l’accès au droit, laquelle n’est pas sans évoquer les accents du New Public Management (NPM). Ensemble hétéroclite de réformes, de pratiques et de croyances, le NPM se confond pas avec le mouvement de privatisation qui a touché certaines économies occidentales depuis une grosse trentaine d’années (Bezes & Musselin, 2015, p. 132).
Dans la mesure où il se caractérise par de nombreux emprunts aux méthodes du secteur privé, mais aussi par l’accent mis sur la parcimonie des coûts au sein des administrations, il lui est néanmoins apparenté : il s’inscrit en effet dans une « tendance à l’amincissement de l’État » (Bezes, 2005, p. 28).
Dans ce cadre, les travaux en sciences sociales se sont intéressés à ce que le privé faisait au public, moins souvent à ce que le public faisait au privé. C’est sous cet angle que les services juridiques rendus gratuitement par les cabinets d’avocat-e-s peuvent être analysés, car ils relèvent d’une intégration originale du don au temps de travail des collaborateurs, mais aussi et surtout d’un circuit de redistribution parallèle à l’impôt et géré à leur main par des opérateurs privés.
Ces services publics « externalisés » apparaissent comme des effets induits du NPM, sous la forme d’une hybridation à rebours, les gouvernements « ne pouvant plus monopoliser, ou même concentrer, la délivrance de services » (Savas, 2000, p. 1736). Ils sont révélateurs du passage, dans la sociologie de l’État, vers une sociologie de l’action publique moins « stato-centrée » (Hassenteufel, 2011, p. 25) que l’analyse classique des politiques publiques.
Au sein des multinationales du droit, le pro bono est en effet organisé comme une véritable policy , c'est-à-dire comme un programme d’actions poursuivi de manière cohérente par une entité collective. Le spécialiste de la question Scott Cummings parle ainsi d’« institutionnalisation du pro bono » (Cummings, 2009, p. 338), avec des politiques impliquant un organigramme et un quadrillage à l’échelle mondiale.
Une telle évolution des law firms, réconciliant dans leur pratique « le service public et celui du capital » (Dezalay, 1992, p. 19) , s’inscrit par ailleurs dans une nouvelle rhétorique de légitimation du capitalisme, fondée sur le thème de l’entreprise citoyenne et socialement responsable. Elle tend donc à tirer le NPM davantage vers le retrait de l’État que vers la réforme des administrations publiques.
Les services juridiques rendus gracieusement par les professionnel-le-s du droit remontent à une tradition ancienne de sollicitude envers les pauvres et les nécessiteux – on peut ainsi penser aux consultations charitables, décrites avec précision dans l’ouvrage majeur de Lucien Karpik (Karpik, 1995).
Action publique et Law firms
Le pro bono renoue ainsi avec les caractéristiques d’une profession animée par une longue tradition d’ethos du dévouement, aujourd'hui amenée à redéfinir son mandat de service public. En termes de politisation, cette « avocature des causes » est davantage orientée par la philanthropie que par un projet global de transformation sociale.
De fait, ce qui détermine le marché du pro bono n’est pas la demande du public, mais les intérêts et les priorités de ceux qui allouent les ressources : via le pro bono , ce sont les law firms qui avancent leur propre agenda, avec des récipiendaires (ONG et associations bien plus qu’individus) triés sur le volet, et des causes (le handicap, l’accès à l’éducation, l’apatridie) soigneusement choisies pour leur résonance consensuelle, facteur d’évitement des confrontations sociales.
Surtout, il ne faut pas que la thématique retenue soit susceptible de porter atteinte aux intérêts des grands groupes que les cabinets d’avocat-e-s conseillent dans une activité – le droit des affaires – qui reste pour eux la plus lucrative, et leur donne en l’occurrence la latitude nécessaire au financement de leur politique pro bono.
Forte de ces éléments de cadrage, cette contribution se fonde sur deux éléments que je retiens comme capitaux pour l’analyse de mon terrain d’enquête : premièrement, l’idée qu’il importe de prendre en compte les emprunts du privé au public, et ainsi voir ce que fait le NPM aux professions du point de vue de l’externalisation des services publics ; deuxièmement, la conviction qu’il faut prendre au sérieux le passage de la sociologie des politiques publiques vers une sociologie de l’action publique, et donc admettre que des opérateurs privés puissent produire des politiques publiques.
Dans ce texte, le pro bono est par conséquent analysé comme un dispositif d’action publique, et les avocat-e-s traité-e-s comme une population témoin fascinante. Ce groupe a en effet, et de longue date, 2 ennemis principaux : le marché et le pouvoir politique, raison pour laquelle il est particulièrement intéressant d’y observer les transformations que le NPM fait subir au monde du travail.
Le pro bono est dans un premier temps appréhendé comme une forme de désétatisation du service public de la justice. Puis, dans un second temps, j’explicite la façon dont les law firms choisissent les destinataires de leurs conseils juridiques, en tentant au passage de décrypter les motivations des avocat-e-s travaillant sur des dossiers pro bono.